Vizea île de France
Vizea Sud-Est
Vizea Grand-Ouest
Vizea Sud-Ouest

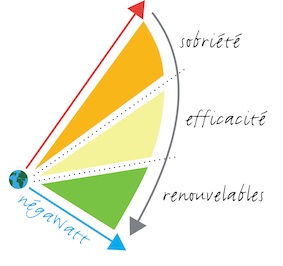
 Plaine Commune accueille sur son territoire 13 000 entreprises et plus de 135 000 emplois. Ce territoire a vu l’arrivée depuis 2000 de plus de 1 400 entreprises représentant une progression d’environ 21 000 emplois.
Plaine Commune accueille sur son territoire 13 000 entreprises et plus de 135 000 emplois. Ce territoire a vu l’arrivée depuis 2000 de plus de 1 400 entreprises représentant une progression d’environ 21 000 emplois.  La Charte a été signée par les premières entreprises en 2005. Actuellement, 85 sociétés sont signataires. La Charte propose 24 actions pour renforcer les liens évoqués précédemment. Les actions à mener par chaque entreprise s’inscrivent dans une démarche volontaire et dépendent du contexte de chaque entreprise. Ainsi, l’entreprise s’engage sur les actions qu’elle souhaite mettre en place dans les trois ans. Cette charte fera par ailleurs l’objet de déclinaisons spécifiques pour certaines entreprises et notamment pour les aménageurs, entreprises de travaux publics et bâtiment. En contrepartie de cet engagement, Plaine Commune, s’engage à faciliter au maximum l’insertion de l’entreprise dans son environnement : aménagement de l’espace public, accueil des salariés, transports, sécurité, services de proximité, etc.
La Charte a été signée par les premières entreprises en 2005. Actuellement, 85 sociétés sont signataires. La Charte propose 24 actions pour renforcer les liens évoqués précédemment. Les actions à mener par chaque entreprise s’inscrivent dans une démarche volontaire et dépendent du contexte de chaque entreprise. Ainsi, l’entreprise s’engage sur les actions qu’elle souhaite mettre en place dans les trois ans. Cette charte fera par ailleurs l’objet de déclinaisons spécifiques pour certaines entreprises et notamment pour les aménageurs, entreprises de travaux publics et bâtiment. En contrepartie de cet engagement, Plaine Commune, s’engage à faciliter au maximum l’insertion de l’entreprise dans son environnement : aménagement de l’espace public, accueil des salariés, transports, sécurité, services de proximité, etc.
 Dans les tuyaux depuis quelques temps déjà, la Région Ile-de-France a officialisé le 17 novembre 2011 la création d’une société d'économie mixte (SEM) francilienne dédiée à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Son entrée en action devrait intervenir à la fin de l’année 2012.
Dans les tuyaux depuis quelques temps déjà, la Région Ile-de-France a officialisé le 17 novembre 2011 la création d’une société d'économie mixte (SEM) francilienne dédiée à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Son entrée en action devrait intervenir à la fin de l’année 2012.« Maîtriser la consommation d'énergie et produire de l'énergie au niveau local sont deux grands défis pour l'Ile-de-France, qui dépend à 90% de ressources importées. Cette situation a un coût : les ménages ne cessent de voir leur facture augmenter et l'argent dépensé pour importer des ressources non renouvelables l'est au détriment du développement économique du territoire [...]. C'est un immense gâchis »
 En complément, cette SEM est aussi destinée à accompagner le développement de grands projets d’énergies renouvelables. Ainsi la SEM prévoit pour le moment d’accompagner financièrement six à huit projets de production biomasse, éolien, géothermie ou autre. Cet accompagnement est destiné à favoriser la création de projets ambitieux qui seraient susceptibles de ne pas voir le jour en raison d’une rentabilité économique insuffisante. Comme le précise Helène Gassin, vice présidente (EELV) du Conseil Régional en charge de l'environnement :
En complément, cette SEM est aussi destinée à accompagner le développement de grands projets d’énergies renouvelables. Ainsi la SEM prévoit pour le moment d’accompagner financièrement six à huit projets de production biomasse, éolien, géothermie ou autre. Cet accompagnement est destiné à favoriser la création de projets ambitieux qui seraient susceptibles de ne pas voir le jour en raison d’une rentabilité économique insuffisante. Comme le précise Helène Gassin, vice présidente (EELV) du Conseil Régional en charge de l'environnement : « Il y a des projets en Ile-de-France, mais le problème est que les investisseurs ont des exigences de rentabilité financière parfois délirantes car la période est difficile. Nous, SEM, pourrons investir dans un projet intéressant sans attendre que ce soit la poule aux œufs d'or ».Au total l’effet de levier visé est compris entre 40 et 70 millions d'euros de projets dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. Dans ces conditions, l’équilibre de la SEM pourrait être atteint dés 2015.
 Le CLER, le RAC-F, l’ADEME et ETD ont mis en place un outil, CLIMAT PRATIC, qui permet d’aider les collectivités à mettre en place une politique climat énergie et à la décliner en permettant l’élaboration d’un programme d’action adapté à la collectivité. En effet, cet outil est principalement conçu pour les collectivités et territoires de moins de 50 000 habitants qui ne sont pas soumis à l’obligation prévue par la loi Grenelle II d'élaborer un PCET (Plan Climat Energie Territorial) avant la fin de l’année 2012, mais qui souhaitent tout de même participer au défi écologique de notre planète.
Le CLER, le RAC-F, l’ADEME et ETD ont mis en place un outil, CLIMAT PRATIC, qui permet d’aider les collectivités à mettre en place une politique climat énergie et à la décliner en permettant l’élaboration d’un programme d’action adapté à la collectivité. En effet, cet outil est principalement conçu pour les collectivités et territoires de moins de 50 000 habitants qui ne sont pas soumis à l’obligation prévue par la loi Grenelle II d'élaborer un PCET (Plan Climat Energie Territorial) avant la fin de l’année 2012, mais qui souhaitent tout de même participer au défi écologique de notre planète. Dans le but d’inciter les établissements publics intercommunaux à mettre en œuvre des PLU intercommunaux, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) a décidé de soutenir 31 territoires qui ont pris l’engagement volontaire de s’inscrire dans cette démarche. La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 avait donné une nouvelle impulsion en la matière en intégrant certaines problématiques territoriales dans le PLU intercommunal avec notamment : les déplacements (PDU), l’habitat et l’urbanisme (PLH).
Dans le but d’inciter les établissements publics intercommunaux à mettre en œuvre des PLU intercommunaux, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) a décidé de soutenir 31 territoires qui ont pris l’engagement volontaire de s’inscrire dans cette démarche. La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 avait donné une nouvelle impulsion en la matière en intégrant certaines problématiques territoriales dans le PLU intercommunal avec notamment : les déplacements (PDU), l’habitat et l’urbanisme (PLH).  Le constat lié à l’impact des politiques de développement économique, social et environnemental a conduit les états, institutions et sociétés à s’inscrire dans un mode de développement qui soit durable. Toutefois, les actions ou politiques de développement durable s’axent principalement sur les thématiques de l’environnement ou de l’énergie et du réchauffement climatique. La portée du développement durable est beaucoup plus large et transversale et couvre notamment la dimension du social qui par ailleurs constitue un pilier à part entière du développement durable au même titre que l’économie ou l’environnement.
Le constat lié à l’impact des politiques de développement économique, social et environnemental a conduit les états, institutions et sociétés à s’inscrire dans un mode de développement qui soit durable. Toutefois, les actions ou politiques de développement durable s’axent principalement sur les thématiques de l’environnement ou de l’énergie et du réchauffement climatique. La portée du développement durable est beaucoup plus large et transversale et couvre notamment la dimension du social qui par ailleurs constitue un pilier à part entière du développement durable au même titre que l’économie ou l’environnement. Le second chapitre du document présente des objectifs ainsi que des exemples d’actions mises en œuvre pour créer un développement social durable selon les trois entités suivantes :
Le second chapitre du document présente des objectifs ainsi que des exemples d’actions mises en œuvre pour créer un développement social durable selon les trois entités suivantes : Ainsi, la circulaire du 3 août 2011 propose de présenter le processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation selon les 5 éléments de démarche du « Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux » :
Ainsi, la circulaire du 3 août 2011 propose de présenter le processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation selon les 5 éléments de démarche du « Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux » : A l’occasion des 1ères rencontres « Energies et territoires ruraux » organisées sur le territoire du Mené dans les Côtes d’Armor (22), a été annoncée la création du « Réseau national des territoires à énergie positive ».
A l’occasion des 1ères rencontres « Energies et territoires ruraux » organisées sur le territoire du Mené dans les Côtes d’Armor (22), a été annoncée la création du « Réseau national des territoires à énergie positive ».
Actuellement composé de 13 membres (collectivités locales, porteurs de projets, structures de soutien) ce réseau a pour missions principales de :

 Le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 précisant le contenu des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des PCET (Plan Climat Energie Territorial) est paru au Journal Officiel le 12 juillet 2011. La loi Grenelle 2 (art. 75) a rendu obligatoire l'établissement de ces bilans, au plus tard le 31 décembre 2012, pour les entreprises de plus de 500 salariés (de plus de 250 salariés en outre-mer), les établissements publics de plus de 250 personnes, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et l'Etat. Le décret définit les modalités d’application des bilans des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des PCET et décline des mesures transitoires en direction des acteurs engagés dans des démarches de réduction des émissions de GES.
Le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 précisant le contenu des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des PCET (Plan Climat Energie Territorial) est paru au Journal Officiel le 12 juillet 2011. La loi Grenelle 2 (art. 75) a rendu obligatoire l'établissement de ces bilans, au plus tard le 31 décembre 2012, pour les entreprises de plus de 500 salariés (de plus de 250 salariés en outre-mer), les établissements publics de plus de 250 personnes, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et l'Etat. Le décret définit les modalités d’application des bilans des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des PCET et décline des mesures transitoires en direction des acteurs engagés dans des démarches de réduction des émissions de GES. Le lundi 11 juillet 2011, la commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié le cahier des charges du nouvel appel d’offre éolien offshore. Portant sur plus de 3 GW (soit environ 600 éoliennes), réparties sur cinq zones prédéfinies dans la Manche et sur la façade Atlantique, ce projet porte les ambitions françaises en termes de développement de l’éolien offshore.
L’appel d’offre s’inscrit dans l’objectif d'atteindre 23% d’énergies renouvelables à l’horizon 2020, alors que la part des énergies renouvelables est actuellement de l'ordre de 12% dont environ 2% pour l’éolien terrestre. Pour rappel, cet objectif a été défini lors du Grenelle de l’Environnement en 2007.
Pour chacun des cinq sites retenus pour l'appel d'offres, une puissance maximale de l’installation a été fixée :
La date finale de dépôt des offres a été fixée au 11 janvier 2012. La liste des candidats retenus sera quant à elle connue en avril 2012 et la mise en place des éoliennes devraient être achevée d’ici 2015. Un deuxième appel d’offres devrait également être lancé d’ici cette date portant ainsi la puissance totale d'éoliennes offshores installées à 6 GW.
Les trois principaux critères retenus pour procéder à la sélection des candidats sont :

 L’élaboration du document s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération et une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique. Il tient compte également d’une évaluation de la qualité de l’air, et de ses effets sur la santé publique et l’environnement, menée à l’échelon de la région et intégrant les aspects économiques ainsi que sociaux.
L’élaboration du document s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération et une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique. Il tient compte également d’une évaluation de la qualité de l’air, et de ses effets sur la santé publique et l’environnement, menée à l’échelon de la région et intégrant les aspects économiques ainsi que sociaux.Page 10 sur 13
