Vizea île de France
Vizea Sud-Est
Vizea Grand-Ouest
Vizea Sud-Ouest

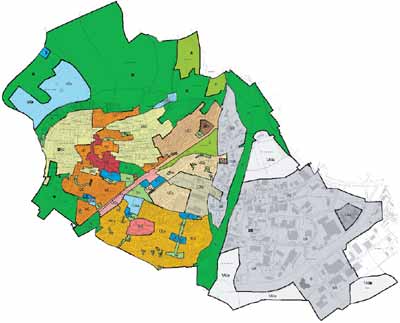 En répercussion au Grenelle 2, le Ministère de l’écologie publie un projet de décret qui vise à assigner aux SCOT et au PLU des objectifs environnementaux et leur permet d’être plus prescriptifs, tout en en étendant le contrôle du préfet (analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, consommations économes, lutte contre l’étalement urbain, obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales…). Ces éléments seront à prendre en considération dans les futures évaluations environnementales.
En répercussion au Grenelle 2, le Ministère de l’écologie publie un projet de décret qui vise à assigner aux SCOT et au PLU des objectifs environnementaux et leur permet d’être plus prescriptifs, tout en en étendant le contrôle du préfet (analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, consommations économes, lutte contre l’étalement urbain, obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales…). Ces éléments seront à prendre en considération dans les futures évaluations environnementales. Le CERTU (Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transport, l’Urbanisme et la construction) et l’ETD (Etude Territoire et Développement), dans leur décryptage de l’impact du Grenelle 2 de décembre 2010, rappellent que la loi Grenelle 2 élargit le champ de l’étude d’impact en simplifiant les types de projets concernés. Il élargit son contenu et renforce les moyens de contrôle de l’administration sur l’ensemble des projets soumis à étude d’impact.
Le CERTU (Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transport, l’Urbanisme et la construction) et l’ETD (Etude Territoire et Développement), dans leur décryptage de l’impact du Grenelle 2 de décembre 2010, rappellent que la loi Grenelle 2 élargit le champ de l’étude d’impact en simplifiant les types de projets concernés. Il élargit son contenu et renforce les moyens de contrôle de l’administration sur l’ensemble des projets soumis à étude d’impact. Dans un rapport annuel du MEDDTL (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement), il est souligné que la mise en place de l'Autorité environnementale a, de manière générale, augmenté le niveau d'exigence pour les études d'impact de projets et permis d'améliorer la prise en compte de l'environnement.
Dans un rapport annuel du MEDDTL (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement), il est souligné que la mise en place de l'Autorité environnementale a, de manière générale, augmenté le niveau d'exigence pour les études d'impact de projets et permis d'améliorer la prise en compte de l'environnement. A l’occasion de la deuxième conférence nationale de la ville durable, la ministre de l’écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, et le secrétaire d’Etat au logement, Benoist Apparu, ont lancé mercredi 19 janvier 2011 le deuxième appel à projets « EcoQuartiers ». Cet appel à projets s'adresse à toutes les collectivités porteuses de projets d'aménagement durable.
A l’occasion de la deuxième conférence nationale de la ville durable, la ministre de l’écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, et le secrétaire d’Etat au logement, Benoist Apparu, ont lancé mercredi 19 janvier 2011 le deuxième appel à projets « EcoQuartiers ». Cet appel à projets s'adresse à toutes les collectivités porteuses de projets d'aménagement durable.  Dans la perspective du lancement de la certification pour les opérations d’aménagement durable prévu pour le 2ème trimestre 2011, CERTIVEA met à disposition depuis le 7 décembre 2010 une version zéro du référentiel de certification, conforme au cadre générique HQE AménagementTM, fruit de la collaboration multi-acteurs mis en place par l’Association HQE.
Dans la perspective du lancement de la certification pour les opérations d’aménagement durable prévu pour le 2ème trimestre 2011, CERTIVEA met à disposition depuis le 7 décembre 2010 une version zéro du référentiel de certification, conforme au cadre générique HQE AménagementTM, fruit de la collaboration multi-acteurs mis en place par l’Association HQE.
 L’écoquartier de La Marine à Colombes entre aujourd’hui pleinement dans sa phase opérationnelle avec le lancement de plusieurs opérations (espaces publics, logements, groupe scolaire, réseau de chaleur). Cet écoquartier, sur lequel LesEnR est intervenu en tant qu’AMO Urbanisme Durable, voit ainsi se concrétiser les différentes orientations d’aménagement durable qui ont guidé la conception de ce quartier tout au long du projet.
L’écoquartier de La Marine à Colombes entre aujourd’hui pleinement dans sa phase opérationnelle avec le lancement de plusieurs opérations (espaces publics, logements, groupe scolaire, réseau de chaleur). Cet écoquartier, sur lequel LesEnR est intervenu en tant qu’AMO Urbanisme Durable, voit ainsi se concrétiser les différentes orientations d’aménagement durable qui ont guidé la conception de ce quartier tout au long du projet. L’écoquartier de La Marine est implanté sur un site de 7 ha anciennement occupé par la Marine Nationale, à l’ouest du territoire de Colombes et en bordure du boulevard Charles de Gaulle, axe structurant support du prolongement du tramway T2.
L’écoquartier de La Marine est implanté sur un site de 7 ha anciennement occupé par la Marine Nationale, à l’ouest du territoire de Colombes et en bordure du boulevard Charles de Gaulle, axe structurant support du prolongement du tramway T2. Peu présents lors des négociations sur le Grenelle de l’Environnement, le Conseil National de l’Ordre des Architectes vient de publier un document destiné aux maires de petites et moyennes communes afin de les guider dans la mise en place d’une démarche de développement durable à l’échelle de leur ville.
Peu présents lors des négociations sur le Grenelle de l’Environnement, le Conseil National de l’Ordre des Architectes vient de publier un document destiné aux maires de petites et moyennes communes afin de les guider dans la mise en place d’une démarche de développement durable à l’échelle de leur ville.
 Alors qu’un peu plus d'une centaine d'établissements d'enseignement supérieur français (soit un tiers du total) ont rempli le référentiel Plan Vert et ainsi réalisé une évaluation globale de leurs pratiques en 2010, ce sont au total 58 campus (contre 34 en 2008) qui ont accepté de partager cette année leurs expériences au travers de ce guide. Ces 58 campus sont constitués de:
Alors qu’un peu plus d'une centaine d'établissements d'enseignement supérieur français (soit un tiers du total) ont rempli le référentiel Plan Vert et ainsi réalisé une évaluation globale de leurs pratiques en 2010, ce sont au total 58 campus (contre 34 en 2008) qui ont accepté de partager cette année leurs expériences au travers de ce guide. Ces 58 campus sont constitués de: L’article 75 de la Loi Grenelle 2 crée l'article L. 229-26 au sein du Code de l’Environnement. Cet article impose aux collectivités locales de plus de 50 000 habitants d'avoir adopté un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) d'ici au 31 décembre 2012. C'est ainsi plus de 500 collectivités qui devront se doter d’un Plan Climat-Energie Territorial avant cette date.
L’article 75 de la Loi Grenelle 2 crée l'article L. 229-26 au sein du Code de l’Environnement. Cet article impose aux collectivités locales de plus de 50 000 habitants d'avoir adopté un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) d'ici au 31 décembre 2012. C'est ainsi plus de 500 collectivités qui devront se doter d’un Plan Climat-Energie Territorial avant cette date.
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) peut être le volet climat du projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, mais constitue avant tout:

Après avoir déjà lancé deux appels à projets en 2008 et 2009 dans le but de développer la filière de production de chaleur à partir de biomasse dans les secteurs de l’industrie, l’agriculture et le tertiaire, l’ADEME vient de lancer, le jeudi 9 septembre 2010, un troisième appel à projets intitulé « Biomasse Chaleur Industrie, Agriculture et Tertiaire (BCIAT 2011) ». Pour rappel, ces appels à projets lancés par l'ADEME sont partie intégrante du Fonds Chaleur Renouvelable destiné à promouvoir les énergies renouvelables dans le système énergétique français afin d'atteindre l'objectif de 23% à l’horizon 2020. Doté d'environ un milliard d’euros sur trois ans (2009 - 2011), le Fonds Chaleur fait partie des cinquante mesures mises en place dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
Comme le précédent (BCIAT 2010), ce nouvel appel à projets porte sur la réalisation d'installations industrielles assurant une production énergétique annuelle supérieure à 1 000 tonnes équivalent pétrole (tep) à partir de biomasse. L'objectif visé à travers cet appel à projets est d’atteindre un bilan total de 175 000 tep/an.
 La phase d’appel à candidatures se déroulera du 8 septembre 2010 au 1er février 2011. L’analyse, la mise en concurrence et la sélection des projets aboutira à la diffusion des résultats et à la notification des propositions d’aides au mois de Juillet 2011. Il est à noter que les installations retenues devront être mises en service avant le 1er août 2013.
La phase d’appel à candidatures se déroulera du 8 septembre 2010 au 1er février 2011. L’analyse, la mise en concurrence et la sélection des projets aboutira à la diffusion des résultats et à la notification des propositions d’aides au mois de Juillet 2011. Il est à noter que les installations retenues devront être mises en service avant le 1er août 2013.
En plus de la mise en place de ce nouvel appel à projets, l’ADEME à également annoncé que le bilan actualisé du BCIA 2009 ainsi que les résultats de l’appel à projets BCIAT 2010 seront en ligne à partir du 2 octobre 2010 sur son site Internet.
 L’édition du mois de mai 2010 de la lettre du CEREN (Centre d'Etudes et de Recherches Economiques sur l'Energie) offre une comparaison des consommations énergétiques de différents modes de chauffage électriques dans le secteur résidentiel individuel, dont font parties les PAC (Pompes A Chaleur) aérothermiques et géothermiques.
L’édition du mois de mai 2010 de la lettre du CEREN (Centre d'Etudes et de Recherches Economiques sur l'Energie) offre une comparaison des consommations énergétiques de différents modes de chauffage électriques dans le secteur résidentiel individuel, dont font parties les PAC (Pompes A Chaleur) aérothermiques et géothermiques. Selon cette étude, les consommations en énergie finale (énergie facturée) de chauffage dans les maisons récentes équipées de PAC aérothermiques s'élèvent à 51 kWh/m², contre 35 kWh/m² pour celles équipées de PAC géothermiques, soit un écart de 31%. Cet écart s'explique notamment par la valeur du COP réel ainsi que par le niveau d'utilisation des convecteurs. En effet, les maisons récentes équipées de PAC aérothermiques recourent davantage aux convecteurs électriques que celles dotées de PAC géothermiques. Il est à noter que les consommations unitaires des PAC géothermiques sont orientées à la baisse ces dernières années, alors que celles des PAC aérothermiques demeurent relativement stables
Selon cette étude, les consommations en énergie finale (énergie facturée) de chauffage dans les maisons récentes équipées de PAC aérothermiques s'élèvent à 51 kWh/m², contre 35 kWh/m² pour celles équipées de PAC géothermiques, soit un écart de 31%. Cet écart s'explique notamment par la valeur du COP réel ainsi que par le niveau d'utilisation des convecteurs. En effet, les maisons récentes équipées de PAC aérothermiques recourent davantage aux convecteurs électriques que celles dotées de PAC géothermiques. Il est à noter que les consommations unitaires des PAC géothermiques sont orientées à la baisse ces dernières années, alors que celles des PAC aérothermiques demeurent relativement stables - Les émissions de GES : La France a enregistré une baisse de ses émissions de GES de 5,6 % de 1990 à 2007 (soit 8,4 tonnes équivalent CO2/habitant émis en 2007). Le bilan apparaît globalement positif mais certains secteurs connaissent toutefois une hausse des émissions de GES.
- Les émissions de GES : La France a enregistré une baisse de ses émissions de GES de 5,6 % de 1990 à 2007 (soit 8,4 tonnes équivalent CO2/habitant émis en 2007). Le bilan apparaît globalement positif mais certains secteurs connaissent toutefois une hausse des émissions de GES.Page 11 sur 13
